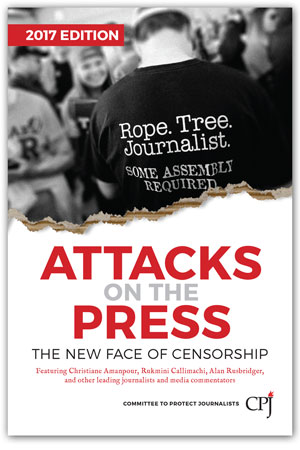Alors même que le pays s’effondre, le gouvernement du Soudan du Sud ne tolère aucune critique
Par Jacey Fortin
JUBA, Soudan du Sud — Les tirs ont commencé un vendredi après-midi vers 17h15.
Des dizaines de journalistes s’étaient rassemblés dans la salle de presse du Palais présidentiel–une enceinte fortifiée aussi appelée « J1 » –dans la capitale. Après plusieurs jours de tensions croissantes, qui ont abouti, la veille, à une fusillade à un poste de contrôle, le Président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, ancien rivaux de guerre, devaient donner une conférence de presse pour lancer un appel à la paix.
Cela faisait deux heures que les journalistes attendaient lorsqu’ils ont entendu des coups de feu à l’extérieur. La plupart d’entre eux se sont jetés par terre. Une femme de la sécurité, qui se tenait près de la porte, était aux prises avec une arme dont elle ne semblait pas savoir se servir, ce qui rendait tout le monde nerveux.
Après environ une heure, les tirs se sont atténués et Kiir et Machar sont finalement apparus, dans un premier temps pour appeler au calme après la fusillade, dont ils prétendaient ne pas savoir grand chose, puis pour lire des discours préparés sur l’état de la nation.
C’était la veille du cinquième anniversaire de l’indépendance du Soudan du Sud.

Les journalistes ont attendu plusieurs heures avant de pouvoir quitter J1 en toute sécurité. Vers minuit, ils se sont entassés à l’arrière de pickups et ont été escortés par des soldats jusqu’à l’hôtel. Aucun d’entre eux n’a été blessé. Certains avaient vu des corps ensanglantés sur le trottoir tandis qu’ils sortaient par les grilles.
« L’incident à J1 », comme on l’appelle désormais dans le jargon gouvernemental, a marqué le début d’une nouvelle période pour le Soudan du Sud. Le pays le plus jeune au monde en a connu plusieurs de ce genre depuis 2005, quand des décennies de guerre contre les forces armées du Soudan ont pris fin et qu’un tout nouveau gouvernement sudiste était censé définir le cadre d’un nouvel État.
Puis l’année 2011 est arrivée, avec son référendum et sa majorité écrasante en faveur de la création d’un État indépendant. De hauts responsables de l’Armée populaire de libération du Soudan, ou SPLA, se sont fixé comme objectif de construire une nation — une tâche titanesque pour un groupe de vétérans de guerre qui avaient bâti leur carrière sur la lutte armée.
Décembre 2013 a marqué le début d’une guerre civile qui entraînerait la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de plusieurs autres millions, et qui opposait les fidèles du Président Kiir, membre du groupe ethnique Dinka, aux fidèles de l’ancien vice-président Machar, membre du groupe ethnique Nuer. En plein milieu de ces bouleversements, les efforts de censure n’ont fait que s’accentuer, tandis que le gouvernement associait souvent les critiques aux sympathisants de l’opposition.
En avril 2016, conformément à un accord de paix, Machar est retourné à Juba pour reprendre ses fonctions de député de Kiir de sorte que les deux puissent présider la formation d’un nouveau gouvernement de transition.
Cet arrangement est devenu de plus en plus tendu. Les affrontements qui avaient éclaté à J1 en juillet s’étaient désormais étendus à toute la ville, provoquant la mort de plusieurs centaines de personnes. Machar et ses troupes ont été contraints de quitter la ville. Tandis qu’il est toujours en exil, des échauffourées, qui rappellent la guerre civile censée avoir pris fin, se poursuivent en dehors de la capitale.
***
Avec chaque période qui passe, l’état de la liberté de la presse et la censure des médias ne font qu’empirer. Même en temps de paix, des efforts concertés ont été déployés pour entraver la mise en place d’une presse libre dans le pays naissant : les journalistes étaient arrêtés, les organes de presse fermés et les lois sur la protection des médias ignorées. La guerre, quant à elle, n’a fait qu’aggraver les choses en créant une atmosphère de plus en plus empreinte de militance et de crainte. Les journalistes savent qu’un article jugé critique à l’égard du Président ou de ses acolytes pourrait leur coûter leur liberté, voire même leur vie. Les responsables gouvernementaux sont connus pour débouler dans les imprimeries dans le but de retirer des articles de journaux considérés comme désobligeants. Même les Nations unies ont entravé l’accès à l’information essentielle pour les journalistes.
Les choses n’ont jamais été faciles, a observé Emmanuel Tombe, directeur adjoint de Bakhita Radio, une station communautaire de Juba. Comme beaucoup d’autres organes de presse locaux, le premier défi de Bakhita consiste simplement à se maintenir à flot dans une économie délabrée. C’est un combat de tous les jours, ne serait-ce que pour assurer le strict nécessaire, comme la rémunération du personnel, le matériel du studio, et le carburant pour les générateurs.
Bakhita est avant tout une station catholique qui met l’accent sur les sermons familiaux et les hymnes religieux. Mais elle présentait aussi trois programmes en anglais consacrés à l’actualité, ce qui lui a valu, depuis sa création en 2006, des actes d’intimidation de la part du gouvernement, des menaces de fermeture, voire même des attaques contre son personnel.
« À l’heure actuelle, avec le conflit, les médias sont encore plus menacés », a déclaré Tombe en août 2016. Dans ce climat d’insécurité, il est non seulement plus difficile d’obtenir un financement communautaire, mais la station a aussi été contrainte de modérer ses reportages politiques, notamment en supprimant « Wake Up Juba », une émission matinale qui sollicitait la participation de leaders gouvernementaux à des débats sur les problèmes locaux. L’émission abordait des sujets divers et variés, de la petite corruption aux bouleversements politiques. La station a aussi admis qu’elle ne prenait plus d’appels d’auditeurs extérieurs pour éviter toute controverse à l’antenne.
« La station pourrait être fermée ou poursuivie en justice ; tout peut arriver », a déclaré Tombe. « Nous devons aussi nous soucier du présentateur du programme. Si le présentateur est en danger, sa sécurité ne peut être assurée que lorsqu’il est au bureau. Mais chez lui, que va-t-il se passer ? Personne ne sait. » Pour le moment, Tombe pense que le meilleur moyen de protéger ses employés est de garder la station à flot malgré les difficultés financières, et de faire profil bas.
Vers la mi-juillet 2016, il était devenu évident que le gouvernement, après avoir chassé les troupes de Machar hors de la ville, était d’autant plus disposé à mettre un frein à la liberté de parole, notamment après une nouvelle vague de violations brutales des droits de l’homme commises par ses soldats à l’encontre de civils. Cette situation a forcé certains journalistes à s’autocensurer, par crainte de provoquer un gouvernement dont l’armée n’a jamais respecté les libertés des médias. D’autres journalistes, locaux et étrangers, ont tout simplement choisi de quitter le pays.
L’un des correspondants étrangers les plus expérimentés au Soudan du Sud, le journaliste pigiste Jason Patinkin, a quitté le pays en août 2016. Il venait tout juste de finir un reportage pour l’Associated Press documentant une terrible pandémie de viols, qui étaient commis, pour la plupart, par des soldats de la SPLA sur des femmes Nuer. « Compte tenu du caractère sensible de l’histoire que j’ai écrite, qui a été vivement attaquée sur Internet par des trolls pro-gouvernementaux dont beaucoup pensent qu’ils sont rémunérés par le gouvernement, je ne me sentais pas en sécurité » a-t-il déclaré. « Donc je suis parti, mais je ne me sens toujours pas en sécurité pour autant chez moi. »
Mais la fuite n’est pas à la portée de tout le monde. « Il est sûr que les journalistes soudanais doivent faire face à des risques et à des restrictions bien plus importants que les journalistes étrangers » a déclaré Patinkin. « Les choses qu’ils doivent endurer au nom de leur foi dans la vérité sur le Soudan du Sud sont tout à leur honneur ».
***
« C’est mon pays. Je connais les personnes qui ont combattu et qui ont péri pour ce pays », a déclaré Hakim George Hakim, un correspondant vidéo sud-soudanais pour Reuters. « Et je crois que la seule différence entre un journaliste et un soldat, c’est que nous luttons avec nos stylos et nos opinions, alors que le soldat a une arme ».
Pour Hakim, le gouvernement et l’opposition méritent les critiques. Mais ses opinions lui ont plusieurs fois attiré des ennuis. Selon lui, le retour de flamme n’est pas dû à son travail professionnel, mais plutôt aux points de vue qu’il exprime sur sa page personnelle Facebook, qui sont, pour l’essentiel, des messages d’ordre général sur le fait que les journalistes ne devraient pas être pris pour cibles et la façon dont le gouvernement et l’opposition ont failli à leurs devoirs envers le peuple. Même si son travail professionnel–principalement de la vidéographie pour une agence de presse–ne peut pas servir de plateforme à ses opinions, il est résolu à exprimer sa pensée sur les réseaux sociaux pour encourager la paix au Soudan du Sud.
En 2016, quelqu’un a pénétré par effraction dans la voiture en stationnement d’Hakim pour y dérober uniquement une enveloppe contenant des documents personnels. Il a déjà été suivi à maintes reprises par des véhicules du gouvernement. Il a été informé que son nom figurait sur une liste d’interdiction de vol à l’aéroport de Juba. Il a reçu des dizaines d’appels téléphoniques anonymes lui demandant de retirer certains messages publiés sur Facebook.
Parfois, ces appels comportaient des menaces de violence. « Quelqu’un m’appelait pour me dire : « Tu veux que ta famille pleure bientôt ? Après t’avoir perdu ? » a-t-il déclaré.
Tous les professionnels des médias qui ont perdu la vie en 2016 n’étaient pas visés à cause de leur travail. Kamula Duro, un caméraman travaillant pour le Président Kiir lui-même, a succombé à des blessures par balles lors des affrontements de juillet, et rien n’indique qu’il ait été visé de manière intentionnelle.
Peu de temps après, un journaliste travaillant pour l’organisation internationale Internews a été abattu alors qu’il avait trouvé refuge dans l’enceinte d’un hôtel à la périphérie de Juba. John Gatluak travaillait pour Internews depuis quatre ans, et était, aux dires de tous, un journaliste réfléchi, professionnel et surtout dévoué. La scarification sur son front témoignait clairement de son appartenance au groupe ethnique Nuer, et selon Internews, c’était l’unique raison–et non pas le travail de Gatluak–pour laquelle il a été sommairement exécuté le 11 juillet 2016.
Cependant, il ne fait aucun doute que le travail des journalistes les met en danger. Lors d’une conférence de presse en août 2015, le Président Kiir a fait une déclaration qui est restée tristement célèbre depuis. « La liberté de la presse ne veut pas dire que vous travaillez contre votre pays », a-t-il déclaré. « Et si quelqu’un parmi eux ne sait pas que ce pays a tué des gens, nous lui en ferons la démonstration un jour. »
Quatre jours plus tard, le journaliste de presse écrite Peter Moi était abattu par des assaillants inconnus alors qu’il rentrait à pied chez lui après le travail. Et en décembre 2015, le rédacteur en chef d’un journal, Joseph Afandi, a été arrêté puis placé en détention pendant près de deux mois, sans doute à cause d’un article critique à l’égard de la SPLA. En mars 2016, quelques semaines uniquement après sa libération, Afandi a été kidnappé, roué de coups puis jeté près d’un cimetière dans la capitale.
« Ils essayent de vous terroriser et de vous faire peur », a déclaré Hakim. « Nous avons de nombreux exemples au Soudan du Sud. Quand une personne n’aime pas ce qu’a fait un journaliste, ses gars, ou son gang, mettent à exécution le plan pour éliminer ce journaliste. Cela se produit souvent. »
Interrogé à propos de ces incidents, le gouvernement se contente de nier l’existence de problèmes quelconques. « Il n’y a pas de harcèlement », a déclaré le ministre de l’information Michael Makuei. « Ces histoires d’intimidation ont été concoctées. Sinon, ils auraient dû nous en informer au ministère. »
Mais les professionnels des médias ici savent que le ministère de l’information n’est pas un endroit sûr. Les journalistes étrangers comme locaux y sont parfois sommés et –longuement–réprimandés par des responsables ministériels et des agents du renseignement qui les accusent de produire des histoires empreintes de partialité contre le gouvernement.
***
Parfois, la sommation n’émane pas du ministère de l’information mais de l’agence de sécurité et de renseignement — auquel cas les journalistes savent que c’est mauvais signe.
Cela est arrivé à Alfred Taban, qui est peut-être le journaliste le plus célèbre et le plus acclamé du Soudan du Sud. Pendant des décennies, il a travaillé dans l’environnement médiatique restrictif de Khartoum, au Soudan. Mais lorsque son pays a obtenu pour la première fois son indépendance en 2011, Taban s’est installé dans le Sud et est devenu le fondateur et le rédacteur en chef du Juba Monitor, qui est désormais le quotidien de langue anglaise le plus en vue au Soudan du Sud.
Pendant tout ce temps, Taban n’a jamais eu peur d’écrire des articles critiques à l’égard du gouvernement. Mais les choses ont changé lorsqu’il a écrit, après les affrontements, un article d’opinion appelant à la fois Kiir et Machar à démissionner. Le 16 juillet 2016, le rédacteur en chef a été sommé de se rendre à l’agence de renseignement où il a été emprisonné. Il ne sera libéré sous caution que deux semaines après.
« [Des responsables] avaient l’habitude de me faire venir dans leurs bureaux pour se plaindre de mes articles, mais nous arrivions, d’une manière ou d’une autre, à trouver un compromis » a-t-il déclaré, assis à son bureau sur lequel s’entassait une pile de vieux journaux. « Mais cette fois-là, de but en blanc, ils m’ont simplement jeté en taule. J’ai vite compris qu’ils n’étaient pas intéressés par le dialogue. »
Au départ, et en dépit des problèmes médicaux dont il souffre, dont le diabète, l’hypertension et une infection paludéenne, Taban s’est vu refuser toute hospitalisation. Cela a changé lorsqu’il a demandé à voir un autre docteur, qui lui, n’était pas de connivence avec les responsables de la sécurité. Il a été libéré de prison peu de temps après.
Après être retourné à son bureau, il s’est rapidement rendu compte que le gouvernement avait recours à d’autres moyens pour censurer son travail : des agents de sécurité en civil se rendaient à l’imprimerie privée où le journal Juba Monitor est produit pour exiger que certains articles soient coupés.
Il pointa du doigt l’édition du 4 août 2016 du journal dans laquelle un espace vide occupait près de la moitié de la page. C’était censé être un article sur Pagan Amum, un vétéran de la SPLA désormais très critique à l’égard du gouvernement, qui avait exhorté un groupe de technocrates à prendre les rênes du pays. Mais les agents de sécurité avaient retiré l’article et demandé aux imprimeurs d’y mettre une publicité à la place.
Taban est intervenu pour retirer la publicité, sachant que les espaces vides en disent long. « Le but est que les gens réalisent que ces actes de censure sont très graves », a-t-il déclaré.
Selon Taban, l’environnement médiatique au Soudan du Sud est pire que jamais. Mais une chose positive est ressortie du temps qu’il a passé en détention : il a eu la chance rare de s’entretenir en personne avec George Livio.
Livio travaillait comme journaliste radio pour la Mission de l’ONU au Soudan du Sud, l’UNMISS, lorsqu’il a été arrêté dans la ville de Wau, à l’ouest du pays, le 22 août 2014. Il est détenu depuis plus de deux ans sans qu’aucune charge officielle n’ait été retenue contre lui. (Le CPJ n’a jamais été en mesure d’établir un lien entre son emprisonnement et son travail de journaliste et ne l’a pas comptabilisé dans son recensement annuel sur les journalistes emprisonnés).
Un responsable de l’agence de renseignement, Ramadan Chadar, a déclaré en août 2016 qu’il n’avait jamais entendu parler du cas de Livio. Et d’ajouter qu’Oliver Modi, le président du syndicat des journalistes du Soudan du Sud — un organe de presse officiellement indépendant et modeste–aurait peut-être davantage de renseignements. Modi était au courant de l’affaire, mais pour lui, c’était « une question de sécurité » du ressort des agences de renseignement.
C’est ainsi que les deux hommes — chacun renvoyant se renvoyant mutuellement le problème alors qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre — se sont lavé les mains de cette question.
Selon Taban, Livio partageait une petite cellule avec trois autres détenus dans une enceinte où des dizaines d’hommes n’avaient accès qu’à un seul cabinet de toilette et n’avaient qu’un seul repas par jour. C’était presque toujours le même plat : des haricots trop salés, a déclaré Taban. Livio a aussi dit à Taban que l’UNMISS n’avait pas été autorisée à lui rendre visite depuis des mois.
« Ce qui me perturbait, c’était le traitement de ces gens. Je ne pensais pas tant à moi ; je pensais à eux. Parce que les accusations à leur encontre sont ridicules », a déclaré Taban, ajoutant que la plupart d’entre eux avaient été accusés de travailler avec l’opposition.
***
Même l’ancien employeur de Livio est resté silencieux. L’UNMISS n’a pas une seule fois demandé publiquement sa libération, et lorsqu’on interroge les responsables sur le sujet, ils affirment toujours qu’ils y travaillent en coulisse. « Nous abordons maintes et maintes fois la question de [sa] libération avec les autorités compétentes », a déclaré Ellen Margrethe Loj, Chef de l’UNMISS, en mai 2016.
À ce jour, cette méthode n’a pas réussi à faire libérer Livio, ce qui ne surprend pas de nombreux journalistes. L’UNMISS entretient une relation tendue avec les médias au Soudan du Sud, après avoir démontré une certaine réticence à relayer des informations essentielles ou même à autoriser des journalistes à accéder à ses camps de personnes déplacées à travers le pays.
Le journaliste pigiste Justin Lynch a pris un avion de l’ONU pour visiter l’un de ces camps, dans la ville de Malakal, au nord du pays, en février 2016. Il s’est trouvé qu’il a atterri au beau milieu d’une attaque brutale. Des hommes portant l’uniforme de la SPLA avaient pris le camp d’assaut, tué des civils et brûlé des tentes. Au bout du compte, au moins 25 personnes ont perdu la vie.
Il était évident que les casques bleus de l’ONU, qui ne sont intervenus que lorsqu’il était trop tard, avaient lamentablement échoué dans leur mission de protection des personnes déplacées.
Presque immédiatement après son atterrissage, Lynch a été sommé par des responsables du bureau de l’information publique de l’UNMISS de partir, mais d’autres employés de l’ONU l’ont encouragé à rester. « Dans la nuit du 17, l’ONU a déclaré que l’attaque avait été perpétrée par des “jeunes armés” » a-t-il déclaré. « Et je pense que beaucoup de personnes à la Mission de l’ONU à Malakal étaient vraiment en colère, parce que nous savions que c’était la SPLA, et nous savions que les casques bleus avaient fui. »
Avec l’aide de ces employés qui avaient pris fait et cause pour lui, Lynch a réussi à éviter à plusieurs reprises les responsables de l’ONU qui essayaient de le localiser pour le mettre dans le prochain avion au départ.
« Dès que vous bloquez l’accès de cette manière, vous créez un environnement fermé dans lequel ces types de problèmes peuvent s’envenimer », a déclaré Lynch. Il est resté au camp pendant cinq jours puis a fini par publier une série de reportages — dont une grande partie dans le Daily Beast — qui remettaient en cause la version officielle des événements de l’UNMISS et mettaient en lumière les échecs des casques bleus. En décembre 2016, il a été déporté du Soudan du Sud.
Patinkin admet que dans un pays où la censure va déjà bon train, l’ONU ne facilite pas les choses. Selon lui, la situation s’est dégradée avec le temps en raison des nombreux obstacles qu’il existe, notamment le refus du personnel de l’ONU de signaler les affrontements, les restrictions d’accès aux camps et les hausses de prix arbitraires des vols de l’ONU.
« Des porte-paroles de l’UNMISS m’ont crié dessus », a-t-il ajouté. « Ce que je veux dire, c’est que le manque de professionnalisme du PIO de l’UNMISS est parfois choquant. »
***
Ce genre d’incidents ne fait que plomber une atmosphère de censure dans ce pays ravagé par la guerre. Et peu importe d’où vient la censure, ce ne sont pas uniquement les journalistes qui en souffrent ; c’est toute la population qui s’est unifiée avec tant d’espoir lorsque le Soudan du Sud est devenu une nation à part entière en 2011. Quand les organes de presse locaux ont peur de critiquer, que l’ONU restreint l’accès, que les journaux sont soumis au bon vouloir des responsables de la sécurité et que les journalistes talentueux ne voient d’autre option que de partir, cela crée un grand vide informationnel que le gouvernement ne demande qu’à combler avec sa propre propagande.
Ici, les journalistes font ce qu’ils peuvent, mais le traumatisme associé aux reportages menés dans un pays comme celui-ci finit par les user. Pour certains, la fatigue est palpable. Les étrangers vont et viennent, quittant le pays lorsque les choses deviennent trop difficiles ou trop dangereuses. Les locaux fuient quand ils le peuvent, bien qu’ils n’aient parfois nulle part où se réfugier.
Selon le vidéo journaliste Hakim George Hakim, quelqu’un doit rester pour défendre l’énorme potentiel du Soudan du Sud. Hakim est persuadé qu’un jour, dans plusieurs générations, un pays pacifique repensera à ces premières années avec soulagement, en se disant que le plus dur est passé.
« Le pays a désormais atteint un stade où le gouvernement a pertinemment conscience que les gens savent que l’État est en pleine déliquescence », a-t-il déclaré. « Et il veut que personne n’en parle. Donc si vous essayez de critiquer la performance du gouvernement, vous aurez des problèmes. »
Mais il dit qu’il continuera d’essayer de toute façon, quoi qu’il arrive.
Jacey Fortin est un journaliste pigiste qui fait des reportages en Éthiopie et au Soudan du Sud.