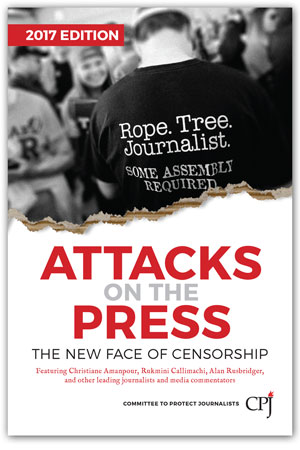Une reporter apprend à esquiver les menaces des terroristes pour couvrir l’histoire
Par Rukmini Callimachi
Le convoi de voitures arborant le drapeau noir d’Al-Qaïda a balayé le nord du Mali en 2012. En quelques semaines, on a eu l’impression qu’on avait fermé les rideaux.
Au moyen de lignes téléphoniques grésillantes, je composais et recomposais les numéros des responsables de la ville qui restaient en général sans réponse. Quand, à l’occasion, une personne répondait, elle ne pouvait pas m’entendre. Lorsque les amputations ont commencé, beaucoup avaient trop peur pour parler.
Cela faisait un peu moins d’un an que j’étais chef du bureau Afrique de l’Ouest de l’Associated Press lorsqu’Al-Qaïda s’est emparé du plus vaste territoire qu’il ait jamais détenu et a commencé à le gouverner. L’étendue du désert sous son contrôle, qui était occupée par la branche nord-africaine du réseau terroriste avec l’aide de deux groupes alliés, était aussi grande que l’Afghanistan. Cela aurait dû être une histoire fascinante, sauf que je ne pouvais pas la couvrir : la branche d’Al-Qaïda qui s’était emparée du territoire avait financé son ascension en kidnappant des étrangers contre des rançons. Peu après que le groupe eut planté son drapeau noir dans l’avant-poste désertique légendaire de Tombouctou, une Suisse – qui avait refusé de partir -a été kidnappée chez elle.
Pendant les 10 mois qui ont suivi, j’ai observé la situation, à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Sénégal voisin, alors qu’on apprenait que des femmes étaient fouettées pour avoir refusé de porter le voile noir. J’ai fait de mon mieux pour décrire la façon dont ils ont détruit les mausolées centenaires de Tombouctou, en passant toute une après-midi à essayer de confirmer, sans succès, le moindre petit détail. « Êtes-vous sûr qu’ils ont utilisé une massue ? » hurlais-je au téléphone. « Ou est-ce que c’était une pioche ? » La plupart du temps, je levais les bras au ciel de frustration.

Pour être honnête, je dirais que n’ai pas réussi à couvrir l’histoire parce que d’une part c’était trop dur, et d’autre part c’était moins excitant : au lieu d’être sur le terrain, j’étais coincée dans mon bureau, obligée de faire mes reportages au moyen d’un téléphone à haut-parleur.
Je n’ai pas fait mes armes au contact d’un autre journaliste, mais en lisant un reportage publié par un groupe de défense des droits de l’homme. Au début de l’été 2012, Corinne Dufka, chercheuse pour Human Rights Watch, s’est rendue à Bamako, la capitale du Mali. Elle passait ses journées à la gare routière centrale où elle attendait les bus qui arrivaient de Tombouctou et qui transportaient des résidents en fuite qui avaient été témoins de la brutalité du groupe. Son reportage était rempli de détails que j’aurais voulu couvrir : comment le groupe terroriste avait interdit la musique sous toutes ses formes, allant jusqu’à bannir les sonneries de téléphone. Elle décrivait comment un jeune homme avait désespérément essayé de décrocher son téléphone quand quelqu’un l’avait appelé et la sonnerie avait retenti au son d’une musique malienne, à portée d’oreille des djihadistes. Selon elle, ils l’ont battu jusqu’au sang.
Cela fut un moment décisif pour moi. De vastes régions du monde sont désormais inaccessibles pour les reporters. Une bonne partie de la Syrie et de l’Iraq, où le groupe militant de l’État islamique a instauré son califat, s’est transformée en zone d’exclusion en raison des dangers de la guerre et parce que les reporters sont désormais des cibles. Il en est de même pour une grand partie de la Lybie, où, jusqu’à récemment, l’État islamique dirigeait la plus importante « province ». La zone depuis laquelle nous pouvons exercer en Afghanistan ne cesse de rétrécir. Et en dépit des interventions militaires appuyées ou financées par les pays occidentaux, une bonne partie de la Somalie, du Nord du Nigeria ainsi que de grandes étendues du Niger, du Tchad et de l’Algérie demeurent des zones à très haut risque pour les journalistes.
Et pourtant, ce qui se passe à l’intérieur de ces zones d’exclusion est plus important que jamais.
Au cours des trois dernières années et demie, je me suis rapprochée des abords des territoires détenus par les groupes terroristes, au plus près de la ligne de contrôle, jetant un coup d’œil furtif par-dessus les sacs de sable, métaphoriquement parlant. Au Mali, je me suis aussi finalement rendue à l’arrêt de bus pour attendre la flotte de bus GDF qui faisaient le trajet de plusieurs jours depuis le cœur du territoire contrôlé par Al-Qaïda. Moi aussi j’ai parlé avec les passagers à leur descente du bus, les femmes visiblement soulagées de ne plus avoir à porter le voile suffocant.
Et j’ai commencé à utiliser de mieux en mieux mon téléphone de bureau, et notamment la fonction de rappel automatique. Je gardais un bloc-notes à côté de mon téléphone fixe dans lequel j’inscrivais tous les appels que je passais, en me disant que je n’abandonnerais pas avant d’avoir recomposé au moins 20 fois le même numéro. Les interviews duraient parfois moins d’une minute avant que la ligne ne coupe, ce qui m’obligeait à rappeler. J’implorais chaque personne que j’appelais de me mettre en contact avec quelqu’un d’autre, pour que chaque appel conduise à d’autres interviews.
Le travail était difficile et souvent fastidieux, mais il a payé au début 2013, lorsque la France a déployé des avions de combat au-dessus du nord du Mali dans le cadre d’une intervention militaire visant à chasser les djihadistes. J’ai atteint la ville de Tombouctou quelques jours après sa libération, aux côtés d’une vague de reporters qui est descendue sur la ville, remplissant chaque chambre d’hôtel disponible. Je n’étais pas la première journaliste à atteindre la ville légendaire, mais j’étais la dernière à en partir, après plus d’un mois, jusqu’à ce que le manager de mon hôtel m’informe que je devrais désormais payer 5000 francs (environ 10 US$) par jour pour payer le cuisinier. « Il n’y a plus d’autres clients, et il vient uniquement pour vous » a fait valoir le manager.
J’avais passé tellement de temps au téléphone à couvrir la ville occupée, que je la connaissais déjà très bien avant même d’avoir foulé ses voies sableuses. J’ai pris la direction de la succursale de la Banque Malienne de Solidarité (banque BMS), qui avait servi de quartier général à la police islamique. Je savais que les djihadistes avaient transformé l’hôtel boutique autrefois si chic en siège de leur tribunal de la charia, et je m’y suis donc rendue après. Les résidents m’ont montré le garage où Abou Zeid, l’un des principaux commandants d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, responsable du kidnapping de nombreux otages occidentaux, avait attendu qu’un mécanicien répare son SUV Toyota, le bâtiment des impôts où ses hommes avaient tapé à la machine leurs décrets, et d’autres édifices municipaux et villas privées dont s’était servi le gouvernement d’occupation.
Dans chaque édifice, j’ai trouvé des dizaines de pages laissées par les hommes d’Al-Qaïda.
Ma compréhension d’Al-Qaïda a reposé, pour l’essentiel, sur ces documents totalisant plus de 5000 pages de correspondance interne et d’opuscules idéologiques qui m’ont également donné un bon aperçu de sa faction, l’État islamique.
C’était une autre façon de regarder par-dessus les sacs de sable, cette fois-ci à travers la petite ouverture laissée par ce qu’ils s’étaient écrits entre eux et ce qu’ils avaient écrit sur eux.
J’ai finalement quitté Tombouctou en mars 2013, et au cours des deux années suivantes, je me suis presque exclusivement consacrée au groupe État islamique. Au début, j’ai eu du mal à trouver l’arrêt de bus métaphorique, où je pouvais interviewer les passagers qui quittaient le territoire sous son contrôle. Je l’ai finalement trouvé lors du premier de nos quatre voyages en Iraq en 2015, dans les villes jonchées de tentes qui avaient émergé à la périphérie de la ville de Dohuk au nord. C’est là que la minorité Yazidi, dont les femmes avaient été réduites à l’esclavage par l’État islamique, avait trouvé refuge. Tous les jours, j’allais de tente en tente pour m’entretenir avec des dizaines de femmes qui avaient été détenues par le groupe terroriste. Elles me racontaient les horreurs de leur captivité – les viols dont avait déjà parlé de nombreux organes de presse, y compris le mien. Ces interviews étaient pour moi le plus intime des regards sur l’état d’esprit des hommes qui revendiquaient agir au nom de Dieu. Les femmes et les filles décrivaient comment leurs agresseurs utilisaient les écritures saintes pour justifier les actes de violence sexuelle. Elles m’ont dit que les combattants qualifiaient leurs viols d’ « ibada », adoration en arabe, et décrivaient comment les hommes qui les tenaient priaient avant le viol, puis prenaient une douche et priaient de nouveau, faisant ainsi de l’abus un acte de dévotion religieuse.
J’étais en Iraq le 13 novembre 2015, lorsque mon rédacteur en chef m’a appelé pour me demander de me rendre de toute urgence à Paris.
J’y suis arrivée le jour suivant et j’ai mis une heure et demie pour couvrir la distance qui prend normalement 40 minutes en voiture entre l’aéroport Charles de Gaulle et mon hôtel, car nous étions obligés de passer par des rues secondaires pour éviter les barricades érigées par les forces de sécurité qui étaient à la poursuite des assaillants qui avaient survécu et qui avaient tué 130 personnes au Stade de France, dans des cafés et au Bataclan. Dès que leurs noms ont été révélés, j’ai rejoint la foule de reporters qui allaient de rue en rue, frappant aux portes d’anciens voisins, ce qui s’est révélé un exercice frustrant et surtout futile.
C’est là que j’ai trouvé une autre petite ouverture, sous la forme de documents d’interrogation et d’archives judiciaires, que j’ai été chercher à Bruxelles en train.
La France compte plus de combattants en Syrie que n’importe quel autre pays occidental et des dizaines d’entre eux ont été arrêtés dès leur retour. Dans les transcriptions d’interrogations de plusieurs heures menées par la Direction générale de la sécurité intérieure de la France, le service de renseignement intérieur, j’ai pu discerner les contours d’une branche de l’État islamique ayant pour seul but d’exporter la terreur à l’étranger. Vers le milieu 2016, une source m’a remis une clé USB contenant plus de 100 000 pages de documents d’enquête, que je passe depuis au peigne fin pour essayer de comprendre comment l’État islamique a réussi à asseoir son instrument de terreur en Europe. Plus récemment, j’ai commencé à recueillir des dossiers d’interrogation similaires en Asie, ce qui démontre la portée internationale du groupe.
Je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque je suis sur le terrain, et je ne peux m’empêcher de lire avec nostalgie les récits des reporters qui ont couvert des conflits il y a plusieurs années, lorsque les journalistes n’étaient pas encore des cibles. Il y a à peine 20 ans, Oussama Ben Laden accueillait une équipe de télévision américaine à l’intérieur d’une cabane au sommet d’une montagne glaciale en Afghanistan. Je me demande si de telles occasions se représenteront encore pour les reporters occidentaux.
En attendant, je continuerai à travailler aussi près que possible des bords.
Rukmini Callimachi a été trois fois finaliste du Prix Pulitzer et couvre l’actualité des groupes militants État islamique et Al-Qaïda pour le New York Times.